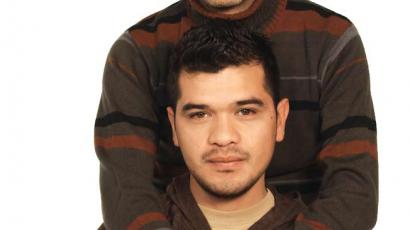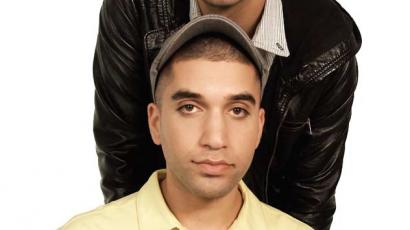Depuis plus de 40 ans, Billi se consacre au « métier d'aider les gens ». Parent et poétesse, Billi est aussi gestionnaire principale d'une organisation communautaire dans un petit village au nord de Toronto qui offre des services d'établissement. Même si elle est hétérosexuelle et qu'elle n'est pas au courant de nouveaux arrivants LGBTQ qui auraient demandé des services à son organisation, elle aimerait en apprendre davantage sur ces questions, espérant soutenir le changement pour que son milieu de travail devienne un environnement plus sécuritaire pour les membres du personnel et les clients LGBTQ.
Billi imagine la complexité et la vulnérabilité vécues en tant qu'homme gai, par exemple, ne serait-ce qu'en essayant de demander des services, alors que les préconceptions quant à l'orientation sexuelle des gens sont tellement répandues. « Ça doit être si difficile de se présenter à un organisme d'établissement et de dire : "Je voudrais parrainer mon partenaire de vie." Pour se faire répondre : "D'accord, comment s'appelle votre femme ?" C'est la présomption automatique... Et si ça se passe dans un cubicule dans un espace ouvert, et qu'un intervenant à côté l'entend, et qu'une autre intervenante dans le coin l'entend aussi, serions-nous en train d'offrir un espace sécuritaire pour que cette personne dise, "En passant, non : je suis gai" ?
Pour Billi, il n'est ni possible ni souhaitable de demander à une personne employée de séparer les divers aspects de son identité et de laisser une partie d'elle-même à la maison chaque jour pour se rendre au boulot. Plutôt, au vu de la diversité de gens et d'expériences qui constituent nos collectivités, elle croit qu'un changement organisationnel favorisant des politiques et des pratiques flexibles est nécessaire afin de mieux soutenir le personnel LGBTQ : « Si nous avons des politiques rigides, alors elles ne sont ni centrées sur le client ni centrées sur les membres du personnel. Elles sont des politiques et des pratiques centrées sur l'organisation. »
Mais les transformations ont lieu lentement et, dans son expérience, elles peuvent se heurter à de la résistance. En effet, Billi se rappelle avoir entendu parler d'une équipe d'intervenants et de gestionnaires dans un autre organisme qui souhaitaient recevoir une formation en matière de diversité sexuelle et de genre. Le conseil d'administration a décidé de rejeter la demande, craignant la perception qu'on se ferait de l'organisation si celle-ci devait commencer à travailler autour des questions LGBTQ. Dans d'autres contextes, Billi a observé que la manière dont la formation à la diversité est livrée peut s'avérer inadéquate. Elle remarque que certains hauts cadres organisationnels peuvent estimer qu'une formation courte et unique suffira, alors que, en vérité, ce n'est souvent pas suffisant. De plus, on privilégie souvent l'apprentissage chez les seuls intervenants de première ligne : « Ma recommandation est que les cadres supérieurs, ainsi que les membres du conseil d'administration, ont également besoin de devenir sensibilisés et bienveillants. »
Le manque de formation et d'éducation a des conséquences sérieuses. De nombreux prestataires de services sont mal informés à propos des questions LGBTQ, et les stéréotypes persistent : « Les gens ne sont pas informés. On a des préconceptions, [et] il y a certains mythes qui circulent, voulant que la majorité de cette communauté porte le VIH, et ainsi de suite. » Dans de petits villages comme celui où Billi vit, l'insuffisance de services pour les personnes LGBTQ constitue également un problème. Alors, beaucoup de gens n'ont pas le choix d'aller chercher des services à Toronto : une solution non satisfaisante étant donné la distance de déplacement que cela leur impose. Dans l'avenir, elle espère qu'il y aura plus de recherche sur ces questions ainsi que des programmes ciblés pour les personnes LGBTQ, où les participants peuvent partager leurs expériences autour d'un repas et avoir un plus grand sentiment d'appartenance à la communauté. Au bout de la ligne, les personnes LGBTQ récemment arrivées veulent participer à la vie de la communauté tout autant que le reste des gens, Bille croit : « Ces personnes apportent les mêmes forces apportées par les autres : leur éducation, leurs compétences, leurs aspirations, leurs rêves. Elles voudraient contribuer à la société. Elles voudraient prendre part aux responsabilités civiques. Elles voudraient participer au mieux-être de la collectivité »